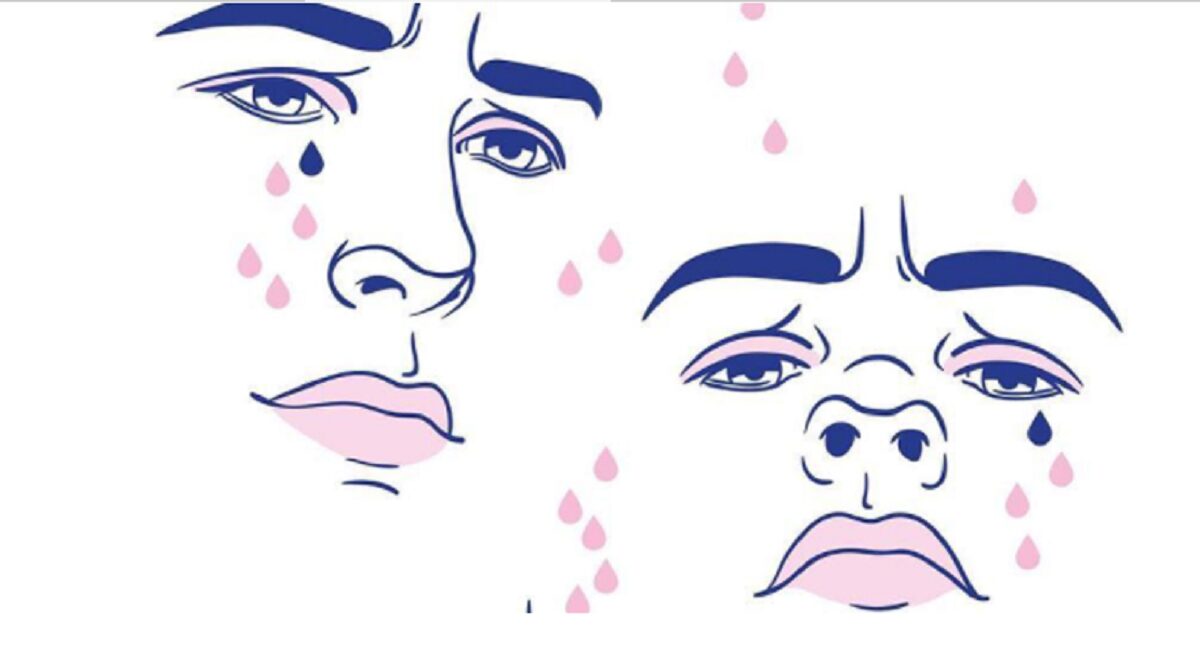En sachant que seulement: «Trois plaintes pour agressions sexuelles sur 1000 se soldent par une condamnation» JURISTAT, 2014
Et en n’oubliant pas que: «La couverture médiatique des crimes, dont les agressions sexuelles, influence les connaissances, les croyances, les attitudes et les comportements de la population face à ces phénomènes» et qu’il «est reconnu que les croyances et attitudes cautionnant l’agression sexuelle jouent un rôle important dans l’existence du phénomène et sur la réponse de la société face à l’agression sexuelle, les médias peuvent jouer un rôle dans la prévention des agressions sexuelles [ou faire l’inverse]. Institut national de santé publique.
Ça fait plus ou moins deux ans qu’on est investi à dénoncer la culture du viol. Chacun de notre côté, parfois ensemble. Dans des textes, des conférences, sur différentes plateformes, à titre de co-porte-paroles de la campagne «Sans oui, c’est non», aussi. Deux ans à ne cesser de voir défiler les histoires d’horreur vécues, à entendre des témoignages, deux ans à également voir que les temps changent, que la sensibilisation fonctionne, que des personnes, à coup de centaines, sont contentes que des mots soient mis sur leur vulnérabilité, leurs malaises. Deux ans donc à se serrer les dents et les coudes devant une violence qui nous dépasse, toujours, autant dans ce qu’elle est que dans ce qu’elle génère dans les espaces commentaires et les réactions médiatiques, encore trop souvent.
Le choix des mots, lorsqu’on est une source d’information, importe.
On peut donc difficilement se fermer les yeux et la yeule sur un «article» tel que celui qui est paru samedi, dans le Journal de Montréal. Média qui, rappelons-le, rejoint des centaines de milliers d’individus, chaque jour, et qui, par le fait même, contribue à la formation de leur pensée et opinions. Le choix des mots, lorsqu’on est une source d’information, lorsqu’on est une vitrine qui doit rendre une image du réel, importe. Et indépendamment de l’avis qualitatif que l’on puisse avoir quant aux contenus dudit média, il reste qu’il est de la responsabilité de celui ou celle qui écrit de songer à la portée des choix faits dans la manière de rendre la réalité. Notamment lorsque ces choix influent sur une partie de la population à propos d’un sujet sensible pour lequel les préjugés contribuent énormément à ce qu’il se perpétue.
La culture du viol, rappelons-le, est une culture qui normalise et banalise, de manière plus ou moins subtile, les violences à caractère sexuel. Ce n’est donc pas une culture qui encourage explicitement les individus à commettre des agressions sexuelles (il est effectivement écrit nulle part «Let’s go, viole»), c’est plutôt que «l’air ambiant» dans les médias, les processus de socialisation, les relations entre les individus, les institutions, font en sorte que oui, des violences ne seront pas reconnues comme étant telles, qu’elles seront minimisées, voire ridiculisées.
Sur fond mélodramatique, une apologie de trois agresseurs reconnus coupables d’agression sexuelle sur une personne de moins de 16 ans.
On mettra la responsabilité de l’agression sur la victime (victim blaming) en insistant sur ce qu’elle a fait pour «chercher l’agression» (consommation d’alcool, vêtements, etc.) ou n’a pas fait pour l’éviter (n’aurait pas dû marcher seule le soir, n’aurait pas dû sortir, etc.); on fera porter une honte bien particulière aux femmes qui assument leur sexualité ou dévoilent des parties de leur corps (slut shaming), ce seront «filles faciles, des chiennes, qui ne se respectent pas», là où les hommes qui auront des comportements similaires seront, eux, bien virils, avec un tableau de chasse rempli; on fera du corps un objet à exploiter, oppresser, à prendre; on questionnera le consentement des personnes en jugeant qu’une absence de oui ne veut pas dire non, que non veut dire oui, etc.
Et ultimement, on cherchera à atténuer la portée des gestes des agresseurs, on les plaindra. Et c’est pile ça que cet «article» nous sert sur fond mélodramatique, une apologie de trois agresseurs reconnus coupables d’agression sexuelle sur une personne de moins de 16 ans.
La personne qui a écrit tout cela s’est permis la largesse d’une critique à l’égard des jurés, de leur capacité à juger.
Les émotions qu’on a voulu faire ressentir à la lecture de ce texte sont de l’ordre de l’empathie envers les familles et les proches des individus accusés et de la tristesse pour ces derniers. On passe plusieurs caractères sur le sujet, voire la quasi-totalité du texte:
- «Les proches des trois jeunes hommes condamnés pour le viol d’une adolescente sont démolis»
- «Le verdict de culpabilité prononcé par le jury, samedi matin, a déclenché une pluie de sanglots dans la grande salle d’audience du palais de justice de Victoriaville. Parents et amis des trois jeunes hommes accusés d’agression sexuelle n’ont pu contenir leurs émotions, plusieurs étant contraints de quitter la pièce de façon précipitée.»
- «La fébrilité était palpable alors que le président du jury s’apprêtait à prononcer des mots qui sont lourds de conséquences pour les trois hommes de la région de Québec.»
- «Cris et pleurs» (sous-titre)
- «Au moment où il a prononcé le premier «coupable», les familles des accusés ont rapidement compris que les jurés avaient choisi de croire la victime et qu’ils seraient séparés de leur proche pendant un bon moment. Le silence de mort qui régnait dans la salle a fait place à une vague de protestation, de cris et de pleurs. Même des membres du jury n’ont pu retenir leurs larmes.»
- Reconnus coupables d’agression sexuelle sur une victime de moins de 16 ans, les trois amis ont été emmenés vers les cellules sans avoir l’occasion de serrer leurs parents et amies de cœur une dernière fois dans leurs bras. Les policiers leur ont passé les menottes et ils ont été conduits en détention.
- «On t’aime», se sont exclamés à quelques reprises les parents des coaccusés au moment où leur fils quittait le tribunal. «Lâche pas, nous serons là à ta sortie», a ajouté un autre proche en guise d’encouragement.»
Le seul “prix” dont on parle, ici, c’est celui des personnes coupables. Pas un seul mot sur celui de la victime.
On peut prendre deux secondes, ici, pour revenir sur le fait que la personne qui a écrit tout cela s’est permis la largesse d’une critique à l’égard des jurés, de leur capacité à juger, voire une attaque contre l’intégrité de leur travail et celle du procès. On émet un verdict de culpabilité lorsque les preuves suffisent et qu’il n’y a pas de doutes raisonnables de croire le contraire. C’est ce qui rend ce genre cause si difficile, souvent, le doute raisonnable. Ce n’est pas une question d’opinions, de croyances, de choix, mais de critères. Et comme le mentionne Maxime St-Hilaire, professeur de droit à l’Université de Sherbrooke: «Une pratique responsable du journalisme se garde bien d’attaquer injustement celles et ceux qui accomplissent ce devoir civique important qui correspond à un droit constitutionnel des accusés».
***
Quand on lit cet autre sous-titre «Une soirée qui coûte cher», on peut difficilement ne pas se rappeler le «That is a steep price to pay for 20 minutes of action out of his 20 plus years of life» du père de Brock Turner plaidant la clémence pour son fils ayant agressé une femme inconsciente, en 2015, à l’extérieur du bâtiment hébergeant une fraternité. Et on peut noter que le seul “prix” dont on parle, ici, c’est celui des personnes coupables. Pas un seul mot sur celui de la victime. En fait, elle passe presque inaperçue, dans tous ces mots à propos d’une “situation” qu’elle a pourtant bien vécue et qui la suivra pendant un bon moment, voire toute sa vie.
Le mot viol n’apparaît qu’une seule fois, dans tout le texte. À la toute fin. Précédé d’un «peut-être».
Une victime de viol est déjà une personne invisibilisée, une personne objectifiée dans le sens le plus fort du terme. Elle est, momentanément, un dévidoir, une chose à prendre, à se passer, même, dans le cas présent. Une personne que l’on ne voit plus et que l’on transgresse à coup de va-et-vient. Le plaisir dans la négation de l’autre. Rien de moins. C’était sans doute la moindre des choses que de ne pas en rajouter une couche, en ne lui accordant même pas un iota des émotions étalées pour le reste de l’assistance. La trace qui reste dans ce journal est celle des hommes tristes et de leur famille triste. Et on n’est pas contre ça, leur tristesse. Elle est bien légitime, c’est vrai qu’ils ont, eux aussi, des sentiments à gérer, une perte à vivre. Mais c’est si souvent ça, aussi, dans le traitement médiatique de ces cas, le poids de la souffrance de la personne qui a subi l’agression et de ses proches, on le silence. Celui des agresseurs, on le rend encore plus lourd qu’il l’a déjà été au sens littéral.
Ce n’était pas «une nuit mouvementée», dernier sous-titre de «l’article», mais «une nuit d’horreur», «une nuit violente».
Aussi, le mot viol n’apparaît qu’une seule fois, dans tout le texte. À la toute fin. Précédé d’un «peut-être» lorsqu’on mentionne la perception de la victime au lendemain de l’événement. On a plutôt choisi de parler de «relations sexuelles répétées». Avec lésions. Dans «une loge du Complexe Sacré-Cœur, dans une Jeep, puis à l’Auberge Hélène». Rappelons-le. Ce n’était pas «une nuit mouvementée», dernier sous-titre de «l’article». Euphémisme du crisse. Quand t’as des bleus sur le corps et des blessures importantes au vagin et à l’anus, c’est «une nuit d’horreur», «une nuit violente», «une nuit dont tu ne veux pas te rappeler», si tu tiens tant à tes sous-titres à sensation.
Me semble qu’il y a une éthique à avoir quand on rapporte des faits. Me semble qu’il y a des limites aux orientations et aux largesses lyriques qu’on peut se donner.
Ce texte n’est pas celui d’un éditorialiste, c’est celui d’une personne qui rapporte un jugement de la cour et qui devrait le faire avec neutralité, malgré toute la difficulté que pose une telle idée. Ce serait tout aussi critiquable, ce ton, venant d’un chroniqueur, mais disons que la part de subjectivité serait plus attendue, peut-être, que là. Peut-être que le choix du narratif est issu de biais, peut-être qu’on a eu le besoin d’humaniser les agresseurs parce que vivre dans un monde où les agresseurs “ordinaires” existent est aussi un monde un peu épeurant, un monde incertain, un monde risqué.
C’est pourtant celui dans lequel on vit.
On va profiter de cet espace pour souhaiter à la victime, à la survivante, du doux, pour la suite des choses et de l’existence. À ses proches, aussi. Qu’elle ait toute l’aide nécessaire.
Cela fait que. Me semble qu’il y a une éthique à avoir quand on rapporte des faits. Me semble qu’il y a des limites aux orientations et aux largesses lyriques qu’on peut se donner. Le seul mérite que ça a, c’est celui de faire perdurer la discussion, d’alimenter le désormais bien débordant vase des “anecdotes”, de nous donner du matériel pour illustrer, avec toujours plus de force et contre ceux et celles qui persistent à nier et à particulariser le phénomène, que la culture du viol existe. Bel et bien. Ici.
Et on va profiter de cet espace pour souhaiter à la victime, à la survivante, du doux, pour la suite des choses et de l’existence. À ses proches, aussi. Qu’elle ait toute l’aide nécessaire. L’écoute. L’empathie. Lui dire que sa vie vaut de quoi, qu’elle vaut de quoi.
Billet de VÉRONIQUE GRENIER & KORIASS
Paru sur Urbania